
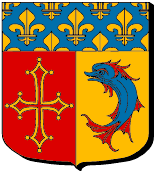
 |
BIBLIOTHÈQUE DAUPHINOISE | 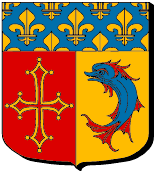 |
| ACCUEIL | LISTE DES OUVRAGES | LISTE DES PERSONNES | ACTUALITES | CONTACT |
| PAGE THÉMATIQUE : Dialectes et patois du Dauphiné |
J.
Lapaume
Professeur de littérature
étrangère près la Faculté
de Grenoble, Membre de la Société des gens de
lettre (Paris) ; de l'Académie impériale
des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, de
l'Académie delphinale, de la Société
de statistique de l'Isère, de la
Société historique et scientifique de
St-Jean-d'Angely, etc, etc, etc.
Anthologie
nouvelle autrement Recueil complet des poésies patoises des
bords de l'Isère.
Tome IVe et dernier, miscellanées.
Introduction, texte revu et traduit,
commentaire et glossaire.
Description de l'exemplaire (Voir : Notes sur la description des ouvrages)
| Grenoble,
Librairie Prudhomme, Giroud & Cie, 1866 In-8° (246r x 160 mm), [4]-LII-600 pp. |
 |
 |
| Pour agrandir, cliquez sur les photos | ||
Notes sur l'exemplaire
Demi maroquin rouge à coins,
dos à 5 nerfs orné de caissons dorés
et fleurons dorés, double filet sur les plats,
tête dorée.
Exemplaire de la bibliothèque de Henry
Massemy avec
son ex-libris (voir ex-libris
dauphinois).
Notes sur l'ouvrage
Cet ouvrage est la publication de 25 pièces en patois de Grenoble et de ses environs, du XVIe au XIXe siècles.
L'ouvrage se compose de :
- Introduction
(pp. I-LII) qui donne une analyse littéraire des
25 pièces. Il s'agit en général d'une
mise en forme du récit, presque une paraphrase, plus qu'une
analyse proprement dite. Signé et daté en
fin : « J. L., 14 mars 1866.
»
- Transcription des 25 pièces (pp. 1-430), avec traduction
en
français. Le texte se trouve sur la moitié
supérieure et la traduction est en-dessous. Les textes
transcrits sont :
I-IV : 4 textes de Laurent de Briançon (pp. 1-151), provenant du Recueil de diverses pièces faites à l'antien langage de Grenoble..., Grenoble, Charvys, 1662. Les notes du Commentaire sont particulièrement développées (pp. 433-479). Elles apportent quelques éclaircissements au texte et, surtout, de nombreuses étymologies et précisions sur le sens des mots utilisés par le poète.
V-VI : Un Noël et une Chanson (pp. 153-158). Il ne donne pas l'origine du premier. La seconde est de Jean Millet. Les notes du Commentaire sont largement développées (pp. 479-486).
VII : Dialoguo de le quatro comare (pp. 159-174), de Blanc-la-Goutte. Dans les notes du Commentaire (pp. 486-488), J. Lapaume affirme que l'on ne possède aucun renseignement sur ce poète, comme s'il ne connaissait pas le travail de Pilot de Thorey dans Grenoble inondé, alors qu'il donne cet ouvrage en référence. Comme pour le Grenoblo Malherou, il a appliqué des modifications orthographiques. Notice sur ce texte et ces différentes éditions : cliquez-ici.
VIII : Epitre sur les réjouissances par lesquelles Grenoble célébra, en MDCLXXXII (1682), la naissance de Monseigr le Dauphin, duc de Bourgogne (pp. 175-202), qu'il n'attribue pas à Blanc la Goutte. Au passage, il considère Laurent de Briançon et Jean Millet comme « les deux maîtres, sans contredit, de notre Parnasse patois. » (p. 488). Ainsi, pour rendre ce texte contemporain de ces auteurs, il modifie l'événement et la date que célèbre cet épitre. Ecrit pour la naissance du Dauphin en 1729, J. Lapaume vieillit le poème de près de 50 ans en l'associant, sans autre raison apparente, à la naissance du duc de Bourgogne en 1682. En revanche, à la différence du Grenoblo Malherou, il a respecté l'orthographe de l'original, à quelques variétés typographiques près : remplacer certains u par v, ou j par i. Notice sur ce texte et ces différentes éditions : cliquez-ici.
IX : Coupi de la lettra ecrita per Blanc dit la Goutta (pp. 203-213).
X : Grenoblo malheirou (pp. 215-250). Cette version du poème fait l'objet de très nombreuses notes dans le Commentaire (pp. 493-519). Nous analysons ci-dessous ces notes. Notice sur ce texte et ces différentes éditions : cliquez-ici.
XI : Grenoblo inonda (pp. 251-276), d'Antoine Reinier. Commentaire : pp. 519-522.
XII-XX
: diverses pièces de « N.
Ménilgrand, mort à Voreppe en 1816 »
(pp. 277-377).
Il
s'agit de prièces extraites de l'ouvrage connu sous le nom
de « Lo Chapitro broullia
»,
un recueil de poésies et de prose en patois de
Grenoble, aujourd'hui attribué aux
frères
André et Gaspard Menilgrand.
XII – Le
Chapitre brouillé
(présentation : pp. XXXV-XXXIX ;
transcription et traduction : pp. 277-306 ;
commentaire : pp.522-528)
XIII et XIV – Chanson
et Palinodie (présentation : pp.
XXXIX-XLIII ; transcription et traduction : pp.
306-317 ; commentaire : pp. 528-529)
XV – Épître
au missionnaire Lambert
(présentation : pp. XLIII-XLIV ;
transcription et traduction : pp.319-321 ;
commentaire : p. 529)
XVI et XVII – A
l'Empereur de France. - Un autre Charlemagne (chansons)
(présentation : pp. XLV-XLVI ;
transcription et traduction : pp. 323-329 ;
commentaire : pp. 529-530)
XVIII – Dialogue
de deux paysans des Granges
(présentation : pp. XLVII-LI ;
transcription et traduction : pp. 331-340 ;
commentaire : p. 530)
XIX – Municipalité
de Voreppe (présentation : p.
LI ; transcription et traduction : pp.
341-350 ; commentaire : p. 530-531)
XX – Blaise
le savetier (présentation : p.
LI- ; transcription et traduction : pp.
351-377 ; commentaire : pp. 531-532)
XXI-XXV : diverses pièces du XIXe siècle (pp. 378-430), parmi lesquelles on peut citer la Journa do Pechou (n° XXI), qu'il attribue dans le commentaire à M. du Terrail, les poésies de M. Martin, de Sinard (n° XXII), etc. Les notes du Commentaire deviennent très succinctes (pp. 532-534). Notice sur la Journa do Pechou : cliquez-ici.
- Commentaire (pp. 433-534). Comme on vient de le voir, les notes apportent quelques éclaircissements au texte et, surtout, de nombreuses étymologies et précisions sur le sens des mots utilisés par les auteurs, avec de nombreuses références au latin et au grec. Dans celles consacrées au Grenoblo malheirou, il brosse un panorama du patois de Grenoble et porte quelques jugements de valeur. Il y a des erreurs dans l'impression de cette partie. A partir du n° XII, qui est numéroté XIII dans le Commentaire, il y a décalage de un dans la numérotation. De même, il y un texte imprimé deux fois aux pages 479-482.
- Glossaire
(pp. 535-600). Page de titre :
« Glossaire » (p. 535).
Première
section. Voyelles A, E, I, O, U, Y, H.
(pp. 537-592). Chaque terme du glossaire est illustré par un
exemple tiré des textes publiés dans la partie
précédente.
Deuxième
section. Consonnes labiales B, P, F, V.
(pp. 593-600). Ce termine au terme
« Begassi »,
avec cette note en bas de page : « La suite
du Glossaire
du dernier volume fait l'objet d'un supplément
séparé. »
Vu l'intérêt
et l'importance
très variables des notes consacrées aux
différents textes dans le Commentaire, il
semble que J.
Lapaume ait surtout voulu étudier les pièces
anciennes de Laurent de Briançon et Jean Millet et
l'œuvre de Blanc la Goutte.
Pour le Grenoblo
malheirou, l'auteur a voulu rétablir
l'orthographe du texte. Pour cela, il part de trois versions
contemporaines, dans les ouvrages suivants :
- Poésies en patois du
Dauphiné,
deuxième édition revue et augmentée,
Grenoble, F. Allier père et fils, 1859, texte
établi par Colomb de Batines.
- Grenoble inondé,
Grenoble, Maisonville, 1859, texte
établie par J.-J.-A. Pilot de Thorey.
- Poésies en patois du
Dauphiné, Grenoble, Rahoult et
Dardelet, Editeurs, 1864, illustrée par D. Rahoult, avec une
préface de George Sand.
Il considère ces éditions comme fautives et
apporte des rectifications en s'appuyant sur les règles
d'orthographe et d'étymologie du dialectes grenoblois qu'il rétablit. Il
ne donne malheureusement pas clairement les principes sur lesquels il
se fonde pour cela. Le meilleur exemple est qu'il privilégie
l'orthographie malheirou,
plutôt que les deux formes
habituellement utilisées : malherou ou malhérou,
en affirmant que « le patois n'emploie
jamais d'accents dans le corps des mots. » (p. 493).
D'où tire-t-il cette règle ? Remarquons au
passage que l'imprimeur du titre de l'édition de 1878, qui
n'a sûrement pas lu
cette savant dissertation, s'en tient à l'usage et
écrit malhérou.
Dans cette étude sur le texte, J. Lapaume ne
renvoie jamais à
l'édition originale du poème. Je pense qu'il
devait aussi la trouver fautive.
Il applique aussi des corrections au Dialoguo de le quatro comare
et à la Coupi
de la lettra.
Ensuite, il en profite pour égratigner largement les
illustrateurs Dardelet et Rahoult (édition de 1864), dont il
relève les nombreux contresens dans l'illustration du
texte. De nombreuses expressions auraient été mal
comprises et les gravures correspondantes seraient ainsi
incohérentes avec le texte établi par J. Lapaume.
Faisant fi de l'étude biographique de J.-J.-A. Pilot sur
Blanc la Goutte dans Grenoble inondé,
il tente de
reconstituer la personnalité du poète,
à partir des quelques éléments que
celui-ci a
disséminés dans son texte.
Pour finir, il juge sévèrement Blanc la
Goutte, en le situant en bas
dans la hiérarchie des poètes patoisants
grenoblois, loin derrière Laurent de Briançon et
Jean Millet. Il lui reproche la forme de son poème, en ne
lui trouvant aucune qualité littéraire.
Curieusement, et non sans injustice, il attribue cela au manque
d'études libérale ou humanités de
l'auteur. En effet, il ne trouve aucune des formes classiques
à ce poème (épopée ou
épître) et fait même appel à
Boileau pour le juger. Aujourd'hui, à la
différence de J. Lapaume, le charme et
l'intérêt que nous trouvons à ce
poème proviennent justement de ce que lui reproche notre
critique, c'est à dire sa liberté de forme et sa
fraîcheur populaire. Il n'est donc pas étonnant
qu'il égratigne aussi George Sand, qui, dans sa
préface à l'édition
illustrée tant décriée par J. Lapaume,
avait pourtant bien compris tout ce que l'on peut tirer de ce texte
« digne d'être entendu et
goûté de toute la France ».
On peut penser que cette édition du poème par J.
Lapaume se veut essentiellement une réponse, un peu
polémique, à cette édition
illustrée de 1864. La
sévérité des critiques semble
s'expliquer par son irritation à l'encontre de la faveur que
connaît déjà le poème et son
auteur.
Historique de la publication de cet ouvrage
Jean Lapaume arrive en octobre 1862
à
Grenoble : « Quand en 1862,
sur la fin
d'octobre, j'arrivai de Rennes à Grenoble, mon premier souci
fut
de m'informer si ma nouvelle résidence offrait des
ressources
pour des études philologiques. Dès le premier
jour, je
mis la main sur les poésies patoises et j'en fis en quelque
sorte ma province. ». Il s'engage alors dans la
publication
d'une Anthologie
nouvelle, qui devait avoir 4 volumes et un glossaire,
comme il l'annonce dans l'introduction du premier volume :
« Elle [la Bibliothèque
elzévirienne]
comprend quatre volumes, dont chacun présente une
Introduction,
un Texte revu et traduit, un Commentaire et un Glossaire. Les trois
premiers tomes contiennent le Théâtre de J.
Millet, qui,
vers 1633, composait et faisait représenter, à
Grenoble,
des pièces que Poquelin, alors âgé de
12 ans,
n'eût pas désavouées plus tard, dans la
maturité de l'âge et du talent.
Le quatrième et dernier volume, sous le titre de Miscellanées,
est consacré à des poésies diverses
qui commencent à 1560 pour aboutir à 1858.
» (p. XII)
En notes, il précise le contenu des 3
premiers volumes (p. XVII) :
«
N.-B. Le théâtre de J. Millet comprend trois
pièces, contenues en autant de volumes, ainsi qu'il suit :
Le tome premier renferme la tragi-comédie de la Lhauda ;
Le tome second, la pastorale de Philis
et Margoton ;
Le tome troisième, la Bourgeoisie
de Grenoble,
comédie en cinq actes. »
Ainsie que l'organisation du glossaire :
« Le Glossaire se divise en cinq sections, selon la
nature
respective et la mutuelle affinité des lettres de
l'alphabet.
Première section. Voyelles : A, E, I, O, U, Y, H.
Seconde section. Consonnes labiales : B, P, F, V.
Troisième section. Consonnes gutturales : G, C,
K, X.
Quatrième section. Consonnes dentales : D, T, J,
Z.
Cinquième section. Consonnes liquides, avec la
sifflante : L, M, N, R et S. »
Il a aussi souhaité en faire un bel ouvrage, comme il l'explique dans cette même introduction : « Si je n'ai pas craint de donner à cette Bibliothèque le beau titre d'Elzévierienne, c'est que rien n'y manque de ce qui peut le mériter. Format de luxe, papier de choix, caractères neufs, tout conspire à en faire une véritable perle typographique, en même temps qu'elle est par son contenu un incomparable souvenir de famille, une antique et pour cela précieuse relique de la petite patrie. » (p. XII).
En définitive aujourd'hui,
de cette première édition, il ne reste que deux
tomes :
Anthologie nouvelle,
autrement, Recueil complet des poésies patoises des bords de
l'Isère. Tome Ier. Théâtre
de J. Millet. Introduction, texte revu et traduit, commentaire et
glossaire,
par J. Lapaume, Professeur de littérature
étrangère près la faculté
de
Grenoble ; Membre de la Société des Gens
de Lettres
(Paris), de l'Académie Impériale des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Bordeaux ; de l'Académie
Delphinale; de la Société de Statistique de
l'Isère ; de la société historique et
scientifique
de St-Jean-d'Angély, etc., etc., etc.
Grenoble, Imprimerie de Prudhomme, 1866, LVI-288 pp. (le texte se
termine p. 282 et se poursuit pas un glossaire inachevé p.
288).
Anthologie nouvelle,
autrement,
Recueil complet des poésies patoises des bords de
l'Isère. Tome IVe et
dernier.
Miscellanées, décrit ici.
Le premier tome débute par une introduction qui décrit tout le projet (p. XII, voir ci-dessus). Il contient une dédicace à J.-J. Champollin-Figeac comme un hommage du cadet à l'aîné qui l'a précédé dans la découverte du patois de l'Isère. Il se qualifie lui-même de « disciple ». Cette dédicace est datée de Grenoble, le 21 octobre 1865, avec cette précision : « En 1863, quand je faisais imprimer un second ouvrage sur le même sujet, il était juste, il était bienséant que je vous offrisse le pieux hommage du fruit de mes veilles. » Fait-il allusion à cet ouvrage ou à un autre ouvrage ? Probablement à celui-ci, si l'on en croit la date de l'introduction. Cela voudrait alors dire que les premières feuilles du premier volume ont été imprimées dès 1863.
Les deux ouvrages sont inachevés. Dans le premier, le glossaire se termine au mot aragnou. Dans le second, comme on l'a vu, le glossaire se termine à begassi.
Il est difficile de savoir ce qui s'est passé pour le premier tome. Selon le Bibliophile de Dauphiné, publié par X. Drevet : « L'édition de cet ouvrage, à peine imprimée, a été détruite et n'est pas entrée dans le commerce. » Le catalogue Perrin le présente simplement comme inachevé. La notice de libraire de l'exempaire numérisé sur Googlebooks affirme : « On sait que l'impression de ce premier vol. n'a jamais été terminée et qu'il n'a, par conséquent, jamais été mis en vente. ». Toujours selon le Bibliophile de Dauphiné, publié par X. Drevet, le tome IV a paru en premier. Il n'y a pas d'informations similaires sur d'éventuelles destructions de ce volume.
Ces aléas dans la publication expliquent probablement la rareté de l'ouvrage. Il n'existe qu'un seule exemplaire au CCFr, à la Médiathèque de Vienne, du premier tome et quatre exemplaires au CCFr, dont un dans le fonds dauphinois de la BMG (U.1167), du quatrième tome (voir détails ci-dessous).
Réception critique de l'ouvrage
A l'envoi du quatrième
volume, Saint-Beuve a réagi par une lettre à l'auteur :
« Ce 13 juillet 1866.
« Je reçois, Monsieur, ce très beau
volume d'Anthologie.
Je m'aperçois, à ma grande confusion, que je suis
très peu juge de plus d'une partie du texte; mais je me
rattrappe (sic)
sur le savant
et intéressant travail du commentateur. Je ne puis, pour
aujourd'hui, que le remercier et le féliciter. Il fait de
très beaux et de très gros enfants, et qui venus
par les
pieds ou par la tête, ont tout ce qu'il faut pour vivre.
« Votre dévoué serviteur, Sainte-Beuve
».
[Rapporté dans Le
Bibliophile de Dauphiné (directeur L. Xavier
Drevet fils), 1892, p. 21]
Il y a un très long article favorable d'Ernest Dottain, publié dans le Journal des Débats politiques et littéraires, du 31 janvier 1867. Il présente l'ouvrage comme s'il avait eu entre les mains les 4 volumes : « Cette vaste anthologie ne forme pas moins de quatre gros volumes in-4° de 600 pages chacun, et elle mérite assurément le surnom d’elzévirienne, que son auteur n'a pas craint de lui donner, par le luxe de son format, le magnifque encadrement de son texte dans de grandes marges, la beauté du papier et des caractères. » Faut-il en déduire qu'il a existé une impression complète de l'ouvrage ? Est-ce une liberté du journaliste qui chronique l'ensemble des ouvrages sur la base des 2 seuls ouvrages parus, en paraissant le faire pour tous les ouvrages dont il connaît la composition par l'introduction du premier volume ? Il termine sa critique par : « MM. les philologues, dont les occupations semblent si innocentes, sont les plus chatouilleux des savans et la patience qu'exige leurs études n'a d'égale que la passion dont les enflamment leurs découvertes. Nous terminerons donc ce court aperçu du nouveau travail de M. Lapaume par une bonne parole c'est que l'œuvre qu'il a accomplie ne pouvait être entreprise par un artiste plus habile ni plus convaincu. »
L'accueil local a été plus mesuré, voire défavorable.
Dans la Revue du
Dauphiné et du Vivarais,
Tome I, 1877, Florian Vallentin avance
: « L'Anthologie de M. Lapaume laisse
beaucoup à
désirer, et n'est pas un ouvrage auquel on puisse accorder
une
grande confiance. » (p. 495).
Albert Ravanat, dans Grenoblo Herou, 1890, dit ironiquement : « recueil qui n'a jamais été terminé et qui est heureusement peu répandu ».
Surtout, lors de la parution de l'ouvrage, cette Anthologie a
donné lieu à une passe d'armes entre
Félix Crozet
et Jean Lapaume devant l'Académie delphinale. C'est
Félix
Crozet qui débute dans un discours tenu devant
l'Académie
lors de la séance du 8 mars 1867. Il commence
par prononcer
les éloges d'usage : « J'ai
remarqué d'abord
que l'ouvrage de M. Lapaume a dû lui coûter un
travail
d'autant plus considérable que, n'étant pas
lui-même du pays, il a dû faire beaucoup de
recherches pour
comprendre le sens d'une foule d'expressions locales qui ne sont pas
connues ailleurs. » Après avoir
rappelé que :
« Né à Grenoble à la fin du
siècle
dernier, et ayant passé ma jeunesse dans cette ville et ses
environs, à une époque où le patois
était
beaucoup plus en usage qu'aujourd'hui parmi les ouvriers et les
habitants de la campagne avec lesquels j'avais de fréquentes
relations, j'ai eu de nombreuses occasions d'entendre et même
de
parler moi-même ce langage pittoresque », F.
Crozet entreprend de s'inscrire en faux contre
les critiques que Jean Lapaume
porte sur
l'édition du Grenoble
Malherou par Diodore Rahoult et Dardelet :
« La forme de cette critique nous paraît
un peu
sévère, comme plusieurs des autres critiques de
M.
Lapaume. Une œuvre d'un mérite
supérieur, comme
celle de MM. Rahoult et Dardelet, pouvait être
traitée
avec plus de ménagement. »
« Cette critique ne nous paraît pas
admissible dans un
sujet qui est tout d'imagination et dans lequel les artistes avaient
liberté entière. »
« M. Lapaume a pris une plaisanterie pour une
erreur, et il
pouvait penser que nos artistes grenoblois connaissaient trop bien le
patois de leur pays pour prendre un verbe pour un chat qui n'aurait pas
de sens. »
« Il nous semble que voilà beaucoup de
bruit pour un t
dans un patois qui ne reconnaît ni orthographe
déterminée, ni barbarismes, puisque c'est un
idiome
parlé et non écrit. »
Sur une dernière remarques de Jean Lapaume, F. Crozet
termine
son article par : « Voilà ce que
M. Lapaume a
trouvé de plus grave à relever dans le Grenoblo
malhérou de l'édition illustrée. On
peut juger
suffisamment de l'importance de ses critiques. »
Jean Lapaume lui répond lors
de la
séance 22 mars 1867, dans un texte argumenté,
mais long,
touffu et plein d'incises, comme il avait l'habitude de le faire. Il
rappelle son ambition, qui situe son ouvrage à un niveau
sensiblement plus élevé que les autres
éditions de
poésies patoises : « Le livre
auquel je ne cesse
de travailler depuis bientôt cinq ans, et qui comprend quatre
tomes d'au moins six cents pages chacun, a pour titre principal :
« Bibliothèque elzévierienne de la
Romane du
Midi.» Cette suscription déclare assez que mes
études portent plus haut et plus loin qu'on ne serait
tenté de le penser si on s'en tenait au second titre :
«Anthologie nouvelle, ou Recueil complet des
poésies
patoises des bords de l'lsère, » et elle a aussi
pour
objet de rappeler que le dialecte rustique du Dauphiné est
à la langue de l'Occitanie comme la partie est au tout, ou
l'espèce au genre. »
A l'argument de Crozet qui argue de sa connaissance du patois
grâce à son origine grenobloise et à
l'usage qu'il
a eu de ce patois dans sa jeunesse, Lapaume répond par cet
argument :
« Or, notre langue française, outre la
généalogie qu'on lui connaît avec le
grec et le
latin, émane encore d'une autre double source; c'est
à
savoir la romane du Nord et la romane du Midi. Et c'est de ces deux
vastes bassins que découlent tous nos patois, sans
exception,
aussi bien ceux de l'Allobrogie et de la Gascogne, que ceux de la
Picardie et de la Flandre. Puis donc qu'il en est ainsi, ne rester
étranger ni au grec, tant ancien que moderne, ni au latin
pas
plus qu'à l'italien, posséder avec cela le
flamand,
l'allemand et l'anglais, l'espagnol avec le portugais, surtout lire
couramment et comprendre de même troubadours et
trouvères
: voilà, souffrez que je vous le dise, M. Crozet,
voilà,
j'imagine, le plus large, le plus court et le plus sûr
chemin, la
route vraiment royale pour arriver à la pleine connaissance,
non-seulement du français, mais encore de ses divers patois,
y
compris celui des bords de l'Isère. »
Autrement dit, nul est besoin d'être né
à Grenoble
pour traiter et comprendre le patois de Grenoble. Il vaut mieux
disposer d'une bonne connaissance des langues et de la philologie.
D'ailleurs ce travail se situe dans une œuvre de plus grande
ampleur : « Au surplus, je sais quelqu'un [il parle
de
lui-même] qui, depuis plus de trente ans, s'applique sans
relâche à approfondir la plupart des langues de
l'Occident, en vue d'un travail qui sera l’œuvre
maîtresse de sa vie entière, et
s'intitulera: Origines
européennes et manifestes de tous les mots de la
langue
française à ses différents
âges. Il n'oublie pas, que dis-je ? il
comprend avec
soin dans ces origines européennes les patois, avec lesquels
le
temps est enfin venu de compter, si jamais on se décide
à
élever, à côté du double
trésor des
Estienne, un monument national qui réunisse la
solidité,
l'ampleur, la richesse, la beauté et la majesté
de ses
aînés grec et latin. Il se fait, comme on voit,
des patois
en général et de celui de l'Isère en
particulier,
une tout autre idée que mon adversaire. »
Après de nombreuses considérations, il
répond
longuement aux critiques de Crozet. Beaucoup de ces discussions portent
sur l'interprétation qui
ont donnée les artistes (Rahoult et
Dardelet) des vers du Grenoblo
Malherou et des
nombreux contresens qu'il relèvent. Il rappelle que les
méthodes de la philologie s'appliquent aussi à
des textes
patois : « Il doit être suffisamment
établi, il
est avéré une fois pour toutes, que
même des
pièces patoises sont justiciables de la critique, tant pour
l'orthographe et la métrique ou la prosodie que pour la
syntaxe;
que par suite, c'est faire tort à Blanc la Goutte que
d'entourer
ses rimes d'un culte aveugle et superstitieux. »
Il justifie ensuite le jugement mitigé qu'il porte sur le
Grenoblo Malherou
: « La plus connue de ses
productions, le Grenoblo
Malheirou,
est loin de valoir les deux moreaux qui viennent d'être
nommés. C'est une œuvre hybride,
exaltée outre
mesure
par les uns et décriée au même
degré par les
autres. », ou encore
: « Oui, dans le Grenoblo malheirou,
il n'y a ni invention, ni ordonnance ou disposition : le lecteur peut y
entrer par en haut, par en bas et même par les
côtés. Ce sont donc des vers, aisés je
le veux,
mais souvent d'une abondance stérile; ce sont des vers,
ai-je
dit, mais pas un poème. »
Il répond ensuite à une critique qui ne lui pas
été faite :
« Comme mon adversaire n'a pas lu le premier volume
de la
Bibliothèque Elzévierienne, il n'a pas eu
l'idée
de me chercher noise sur l'ordonnance et le plan de mon Glossaire. Mais
il est de ma loyauté comme de mon courage d'aller au-devant
de
l'objection qui pourrait m'être faite par lui ou par d'autres
à cet égard. »
Il termine et conclut :
« Etrange fortune du patois de l'Isère !
ces
poésies rustiques à peine sont-elles
évoquées de l'oubli
immérité où
elles languissaient depuis des siècles, qu'un Grenoblois, M.
Crozet, les avilit et les outrage en les accusant de ne
connaître
ni orthographe ni prosodie; et c'est précisément
à
deux étrangers, l'un de Figeac, l'autre de Langres, qu'il
était réservé, à
près de soixante
ans de distance, de comprendre, de chérir et de venger des
productions si dignes, à tous égards, de revoir
la
lumière du jour. », puis
« On sait
également à quoi s'en tenir sur le
système «
anorthographique » infligé au patois par M.
Crozet, comme
sur l'entière liberté dont il gratifie les
artistes pour
les oeuvres d'imagination en général, et en
particulier
pour l'illustration des textes.
J'ai montré si même les poésies
patoises sont ou ne
sont pas justiciables de la critique, autant pour l'orthographe et la
métrique ou la prosodie que pour la syntaxe, en
même temps
que j'ai fait voir si la folle du logis ne demeure pas toujours la
vassale du goût, du bon sens de la raison et aussi du savoir.
J'ai donné à décider si,
discréditant
d'avance ma version déjà commencée,
les
éditeurs du Grenoble
malheirou étaient
fondés
à rendre des oracles comme les deux suivants: 1°
« Le
texte des poésies patoises ne saurait être
rectifié
sous peine de sacrifier souvent la rime et la justesse du vers;
»
2° «dans une traduction, l'énergie du
patois aurait
disparu pour ne laisser qu'une froide imitation. »
On comprend que les Grenoblois aient vite oublié Jean Lapaume qui a quitté la ville dès 1868. En revanche, je m'explique mal pourquoi Xavier Drevet a jugé bon de rééditer cette Anthologie dont la valeur n'était reconnue ni localement (peut-être pour de mauvaises raisons d'amour-propre régional), ni, plus généralement, par les philologues et les spécialistes des patois.
Edition de 1878
En 1878, le libraire Xavier Drevet a publié une nouvelle édition de cet ouvrage dans la Bibliothèque historique du Dauphiné : Recueil de poésies en patois du Dauphiné. Ce n'est que la reprise pure et simple des feuillets d'impression de l'édition de 1866, avec de nouveaux titre et faux titre et sans le glossaire. Elle est beaucoup plus courante.
Références (Voir : Liste des sources et références)
Notice biographique de Jean Lapaume.
Bulletin
de l'Académie delphinale, 1867 :
Observations sur un
ouvrage de M. Lapaume intitulé : l’anthologie
nouvelle ou recueil complet des poêsies patoises des bords de
l'Isère, par M. Félix Crozet.
Séance du 8 mars 1867 (pp. 136-146)
Réponse de M.
Lapaume à M. Crozet ou Défense du patois de
l’Isère, par un étranger contre un
Grenoblois (pp. 176-212).
Un exemplaire numérisé du premier tome sur Googlebooks : cliquez-ici.
Perrin : 540, pour les 2 tomes.
Maignien (catalogue) : 15855 pour les 2 tomes.
Exemplaires au CCFr :
LYON – BM : 132474
(numérisé sur Googlebooks : cliquez-ici. Il ne comporte que
568 pp. Il manque les deux derniers cahiers.)
VIENNE – Médiathèque :
A 9045 (Il ne comporte que 534 pp. Il manque les trois
derniers cahiers.)
BEZIERS – CIRDOC : CAC 2273-4
GRENOBLE - BM-Etude Patrimoine : U.1167